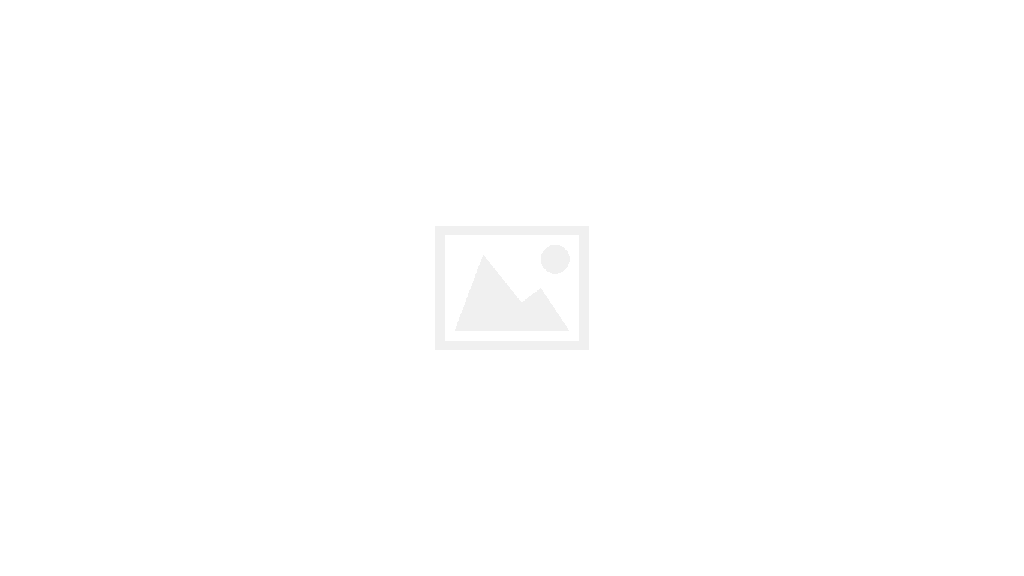Tous les sondeurs, tous les analystes le confirment : les Français râlent sans cesse, mais confessent globalement qu’ils sont heureux. Pourquoi pas ?
Passe ton bac d’abord !
Pour comprendre comment fonctionne, dans nos petites têtes, le système des « idées obligées » qui composent le culturellement correct, il suffit de faire l’historique des sujets du bac philo. A l’époque de l’explosion de la linguistique structuraliste, les sujets sur le langage tombaient en avalanche. Après l’inquiétant succès du Grand bleu et la « delphinomania » planétaire qui l’accompagna, on vit déferler des interrogations sur les rapports (tendus) entre l’Homme et la Nature (avec un net avantage à la Nature, et de gros coups de pieds au cul à Descartes, jadis héros national, et devenu dépeceur de bébés-phoques). Comme on avait une Révolution à commémorer et qu’il était de bon ton, chez les essayistes masochistes, de ne parler que de la Terreur, il y a eu à la fin des années 80 des tapées de sujets sur l’Histoire, son immoralité, ses devoirs de mémoire et les orgasmes de la repentance. La vigueur philosophique française s’est alors épuisée dans les vasouilles de la « French theory », à la fois objet de sarcasmes et produit d’importation pour les non-penseurs américains (Derrida, c’est comme le Chanel n°5, on en porte seulement pour sortir le soir). Au niveau du bac, cela s’est soldé par un certain désarroi : le Moi et ses incertitudes furent l’objet d’une romantique attention.
Comble de malchance, la stratégie complaisante de cooptation entre exégètes d’Heidegger ayant vidé nos Sorbonne de toute tête pleine, on s’avisa ensuite de dissoudre les sujets du bac philo dans la conversation de bar-tabac (« Puis-je être certain d’avoir raison quand je dis que tu as tort? ») ou les thèmes les moins problématiques des Sciences Humaines (« Les civilisations sont-elles mortelles, ou alors quoi ? »). Une place de plus en plus grande fut alors consacrée aux sujets sur l’Art, parce que ça ne mange pas de pain, que c’est la question de cours typique, parfaitement adaptée au plan en trois parties avec conclusion en « Finalement, moi je pense que… ». Cette tendance a encore ses chauds partisans aujourd’hui, et passionne d’autant plus les décideurs de sujets que les musées d’Art contemporain font faillite et compteront bientôt plus de gardiens syndiqués FO que de visiteurs. Que l’on évoque le questionnement récurrent sur la Vérité (avec des sujets qui poussent au scepticisme) et à la Science (avec des questions qui engagent à cramer tout positivisme) et l’on aura fait, en gros, l’état des lieux. On pourra alors sortir du placard le beau marronnier du mois de juin : faut-il maintenir la philo au bac, au cas, évidemment, où on conserverait le bac (un marronnier peut en cacher un autre). Quoi qu’il en soit, cette année, le bonheur était officiellement au menu, cela courait sur le net bien avant que les sujets soient sur les tables, non parce qu’il y avait des fuites, mais parce que la question est d’actualité…
Le bonheur, passion française ?
Il est bien connu qu’un certain Saint-Just, Conventionnel de son état, déclara en conclusion d’un court, mais roboratif discours de motivation révolutionnaire, le 3 mars 1794 : « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». En fait, ce n’était guère qu’un petit rappel de l’article I de la Constitution de 1793, spécifiant que « le but de la société est le bonheur commun ». Pourquoi « en Europe »? Parce que les constitutions de certains des Etats-Unis avaient déjà mis en avant cette idée forte, reprise dans la Déclaration d’Indépendance de 1776. Cette tension vers le bonheur est un produit des Lumières, une graine de liberté propre à germer d’abord dans des pays neufs, sans rois ni prélats omnipotents installés là depuis des siècles, raison pour laquelle il n’était pas sot de les décapiter. Car cette nouveauté confie désormais à un corps politique, la société, la tâche que prétendait assurer l’Eglise, dont la monarchie n’était que le prolongement –deux obstacles radicaux. Alors, revendiquer ce « bonheur commun » au lieu d’inviter l’individu à ne s’occuper que de son Salut, c’est proprement une révolution, et pas seulement un pétard post-spinoziste (ceci pour les connaisseurs). Et il se trouve que, depuis lors, la question du bonheur est tout, dans notre culture française, sauf une question de dissertation philosophique. La preuve : dans ses œuvres complètes, le père sauveur de notre république, Charles de Gaulle, prenait la peine de prendre pour objectif « ce degré relatif de bien-être et de sécurité que pour un peuple, ici-bas, on est convenus d’appeler le bonheur »…Un bonheur de ménagère souriante qui fait son repassage en écoutant Dario Moreno sur son transistor tout neuf pendant que son Marcel bosse chez Renault soixante heures par semaine.
Mais le père De Gaulle, prudent, ajoutait : « relatif » et surtout « ici-bas », car son catholicisme plaçait le bonheur parfait dans l’au-delà. Et sur ce point, sa pendule retardait. L’idéologie républicaine française ne compte pas sur Dieu pour rendre heureux le citoyen. Si l’on veut mesurer quelque part la laïcité foncière de notre culture, c’est bien là. Il suffit d’observer que, dans les culture empêtrées dans le puritanisme vaguement déiste véhiculé aux Etats-Unis par les émigrés protestants anglo-saxons, le bonheur est systématiquement déconnecté du Plaisir et raccordé par des câbles grossiers à la Moralité. Nous, on n’emmène Dieu ni à table, ni au lit. Pas même au lit d’hôpital. C’est comme dans le Festin de Babette : chez certains être trop vertueux et bigots, la vie n’est pas faite pour (bien) manger, mais pour se nourrir. Il n’y a finalement qu’une preuve matérielle de cette approbation divine au bonheur d’un individu qu’on appelle ou non « grâce », c’est sa réussite sociale, qui est supposée traduire sa parfaite adaptation au biotope et aux bonnes mœurs. Ailleurs, dans les cultures anglaises et nordiques, l’Ennui n’est pas le contraire du bonheur : il garantirait plutôt une certaine tranquillité de l’âme, tempérée par l’alcool si nécessaire, mais uniquement le vendredi soir. Il est étonnant de voir que cette modélisation de l’ennui comme vertu, qui passe pour la posture caricaturale des gens « comme il faut », cohabite socialement avec une tolérance étrange à l’excès, à la violence même (le hooliganisme), voire à la marginalité plus ou moins pittoresque. C’est dans ce contexte, et sur des critères élaborés à cette aune, qu’ il appert de divers classements que le Danemark serait le pays le plus heureux du monde, idée assez effroyable pour un Français peu inquiet de se voir, dans le même classement, attribuer des places peu reluisantes (entre 32e et 60e). Et dans le même temps, jalousés pour leur complaisance traditionnelles aux plaisirs de la bouche et du corps, leur climat ensoleillé mais tempéré, leur bon goût en matière de monuments historiques et leurs villes pleines de bistrots sympas, les Français voient déferler des touristes nordiques avides de se désennuyer et des Anglais ravis de s’évader en devenant propriétaires d’une maison rurale si grande qu’ils en font aussitôt un bed and breakfast condamné à la faillite. Le french paradoxe n’est pas qu’une affaire de graisse d’oie.
![]()
La préoccupation française pour un bonheur « positif », aimable à vivre en tout cas, se traduit politiquement par un trait qui souvent passe inaperçu : alors que l’influence anglo-saxonne pense régler la question du bonheur en « sécurisant » des droits et en favorisant, depuis les années 1950, la consommation, nous accordons un prix particulier (souvent jugé exorbitant par nos amis étrangers…) non seulement aux libertés et à l’égalité, mais encore à cette protection sociale qui est, à nos yeux, la seule preuve véritable que la société se soucie de notre bonheur. D’où l’incessante querelle sur les « droits acquis » en la matière, qui relèvent de la géologie comme socle du contrat social made in France. A rebours, on comprend mieux le caractère manifestement réactionnaire et barbare, par rapport à nos usages, d’une rébellion comme celle des anti-mariage pour tous, qui réclament non un droit, mais le refus d’une liberté. En l’occurrence, cette volonté d’interdire le bonheur, surgissant dans un pays comme la France, a d’autant plus déconcerté l’Europe que partout ailleurs, l’accoutumance à une tolérance progressait généralement sans chaos– un Tea Party français, quelle horreur ! Il y a là l’indice d’une crise, et d’une crise grave. Cela n’a rien à voir, ce me semble, avec un retour en force des fous de Dieu, les églises continuent, Dieu merci, à être vides. Ce qui est grave, c’est que l’opposition de droite au gouvernement en place ait décidé (sans unanimité, et avec des degrés) de prendre appui sur ces pèlerins pour envahir la rue et semer un souk politique au lieu de leur laisser danser un rigodon avec les ultimes Camelots du Roi et les fondamentalistes du non-regretté Mgr Lefebvre. Aveu d’inefficacité politique, ou reniement culturel ?
Le manège désenchanté
En fait, aucun politique aujourd’hui ne pourrait prétendre, par son action, procurer du bonheur. Plus de justice, oui ; une égalité mieux respectée, la promesse est raisonnable ; mais du bonheur ! A moins que l’on considère l’historique « travailler plus pour gagner plus » de Sarkozy comme une recette de bonheur : le bonhomme, lui-même sur-consommateur de tout, a incarné, ou a voulu incarner, avec sa Rolex, son insolence et ce que l’on a appelé son « bling-bling », une société où le bonheur se vérifie comme dans les magazines, par des possessions symboliques (la villa, la piscine, la belle auto allemande…). Autrement dit, en allant jusqu’au bout, cyniquement, d’ un « bonheur à hyper-consommer » qui a, prétendument, donné à la société de consommation son aristocratie, sur-peuple de people qui domine et nargue le peuple fasciné par tant de luxe, tant de gaspillages et néanmoins tant de problèmes sentimentaux plus ou moins futiles – all that money can’t buy… Le drame, le vrai, c’est que ce coup de trompette bouffon a surgi à la veille d’ une crise qui a montré, notamment, que l’enrichissement, condition de ce bonheur de riches, s’opérait nécessairement au détriment des pauvres, et non seulement persistait dans l’appauvrissement d’autrui, mais encore, les statistiques le prouvent, s’en nourrissait. Le bonheur des uns (les happy fews des plafonnés fiscaux de Sarko) fait donc effectivement le malheur des autres, cela s’appelle le capitalisme, monsieur Piketty vient de le rappeler à ceux qui l’avaient oublié. Mais pour autant, on ne voit point se profiler de remède de rechange au bonheur de la consommation. Des solutions individuelles ? Vous en trouverez dans la méditation, c’est tendance, un néo-mysticisme plus discret que le stage en ashram, ou dans l’hédonisme à tout crin, fondé philosophiquement chez Onfray, musicalement par les DJ, chimiquement par les drogues. Mais quid de ce « bonheur commun » qui faisait révolution ?
On a parlé du « désenchantement du monde » (l’expression est attribuée à Max Weber) lorsque la religion ou la magie (en fait, c’est pareil) ont cessé, par leurs histoires fantastiques, de faire croire que le monde était l’antichambre du bonheur. Depuis lors, l’amélioration quasi planétaire des conditions de vie (il y a encore des misères archaïques, certaines étant entretenues, justement, par des religions obscurantistes et meurtrières) n’a pas suffi à le ré-enchanter. La médecine soignait ? Depuis l’invention des antibiotiques, elle guérit. L’économie nourrissait ? Elle a permis de spéculer et de bâtir des empires. La technique soulageait l’effort ? Elle a supprimé l’espace et le temps. Et avec ça, vous n’êtes pas heureux ? Non, parce que toutes ces avancées ont vu surgir leur antidote pessimiste, l’idée que les remèdes tuent, que l’économie creuse l’injustice, que la technologie assassine la planète, et tout cela est au moins partiellement vrai. Au moment même où l’on peut considérer comme valide la thèse selon laquelle la croissance est la seule solution à la crise, on sait aussi que la croissance n’est pas une loi physique, encore moins une loi économique, et n’a aucun avenir garanti. C’est face à cette situation que dans l’horizon démocratique, les nuages ont commencé à peser lourdement sur le politique. Certes, les politiques, par leur futilité souvent caricaturale, ont pu contribuer à dévaloriser le politique. Mais finalement, je crois que la dégénérescence idéologique globale, gauche et droite confondue, est plutôt une conséquence qu’une cause de cette dévaluation, que certains appellent « déception », ce qui signifie, implicitement et étymologiquement, tromperie. La désaffection vis-à-vis des partis non-démagogiques est telle que la tentation permanente de la démagogie fait des ravages dans notre paysage politique et syndical (vous aurez certainement des exemples à portée de main). Le bonheur, en tout cas, est sorti de notre culture politique pour longtemps, je le crains…
Le saviez-vous ? La France est le pays au monde qui compte le plus de piscines par habitants. Véridique. Avec un pareil score, on peut s’imaginer que notre classe moyenne ne nage pas dans la misère, mais dans l’eau chlorée. Aucun pays, paraît il, n’a une offre culturelle aussi variée et riche que le nôtre. Je veux bien le croire. C’est sans doute parce que, depuis François Ier, on prend grand soin des artistes, surtout quand ils sont bons. Et nous avons une quantité de fromages dont certains, affinés sur bois, tueraient l’américain moyen qui, comme l’Anglais, lave le poulet avant de le faire cuire. Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, alors ? Selon l’Equipe, c’est la Coupe du Monde. Selon le Figaro, c’est le retour de Sarko. Selon moi, c’est un peu moins de piscines, de poujadisme, de pessimisme, et un peu plus de solidarité, de patience, de mesure. C’est un chantier politique, ça, ne vous y trompez pas.









 Comme
Comme